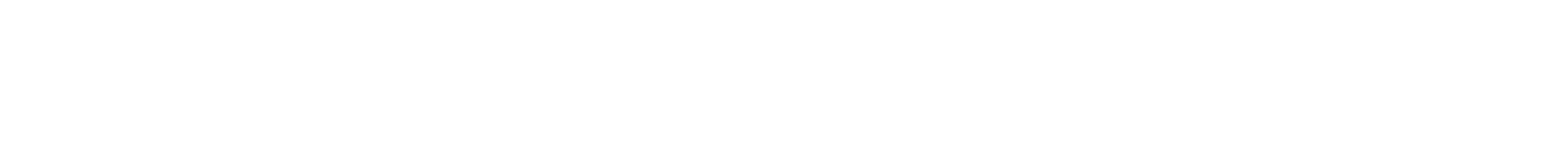Entretien entre Edgar Morin et Pablo Servigne, en décembre 2019. Une version longue de l’interview, avec des passages inédits.
Il est, dit-on, un penseur «indiscipliné». Il ne colle à aucune étiquette car il les embrasse à tour de rôle, puis prend de la hauteur. Il traverse les disciplines pour les organiser, les tisser, faire des ponts : sociologie, philosophie, histoire, économie, physique, biologie, épistémologie… Il a synthétisé, organisé et finalement popularisé la pensée complexe. Aujourd’hui très reconnu et admiré en Amérique latine, où des universités portent son nom, il l’est toutefois moins en France, où les savoirs et les habitudes académiques restent toujours très cloisonnés.
Auteur prolifique, penseur du présent, écrivain subtil à la plume parfois carrée, parfois fluide et poétique, Edgar Morin a été le témoin d’un siècle tourmenté, pour ne pas dire fracassé, toujours présent à son temps, avec le regard d’un aigle, aussi acéré que global. Intellectuel engagé, son premier acte politique, pendant la guerre d’Espagne en 1936 – à 15 ans ! – a été d’apporter un paquet à Barcelone aux forces républicaines et anarchistes. Son moment d’engagement le plus marquant a été la résistance contre l’occupation nazie.
Lire aussi notre interview de Bruno Latour : « l’écologie réussit l’exploit de paniquer les gens puis de les faire bailler d’ennui. »
Son oeuvre, ou disons une partie (car je n’ai pas tout lu), et plus précisément sa manière d’expliquer la pensée complexe et l’organisation de la connaissance, nous a profondément influencés, Raphaël Stevens et moi, pour l’écriture de Comment tout peut s’effondrer (Le Seuil, 2015). On peut dire qu’Edgar nous a «décomplexés» sur notre manière transdisciplinaire, horizontale, systémique, d’aborder le monde, les catastrophes, l’entraide, etc. Il est pour nous une sorte de héros, de père spirituel.
Nous nous sommes rencontrés pour la première fois en janvier 2019 à l’occasion d’une conférence commune à Montpellier sur le thème ‘Effondrement et Complexité’. Lors d’une rencontre ultérieure, plus personnelle, le tutoiement est naturellement venu, avec beaucoup d’affection, comme avec un grand père adoptif. J’ai l’impression d’avoir passé une demi-journée avec Héraclite ou Darwin… d’avoir voyagé hors du temps.

PABLO SERVIGNE
Cher Edgar, nous sommes en avril 2019, tu as 97 ans, tu as traversé un siècle. Qu’est-ce qui te maintient debout ?
EDGAR MORIN
C’est l’amour et la curiosité.
PS • Ton oeuvre est immense, multicolore, protéiforme. Comment pourrait-on la résumer, l’esquisser ?
EM • Rétrospectivement, je vois que toute mon oeuvre est centrée sur le problème à la fois de la connaissance et de l’humain. Il y a une phrase célèbre de Kant qui dit : «Que puis-je savoir, que puis-je croire, que puis-je espérer ? Et pour répondre à ces questions, il faudrait que l’on sache ce que c’est que l’Homme.»
Mon adolescence s’est passée dans une époque où se posaient de façon insistante ces questions «que puis-je croire ?» et «que puis-je espérer ?». Je m’en souviens très bien : c’était en février 1934, il y a eu une émeute à Paris contre le parlement, et la politique est entrée dans notre classe. Des élèves étaient pour la droite, d’autres pour la gauche… Dehors, il y avait le pouvoir hitlérien, la guerre d’Espagne, Munich, la montée de la guerre, la crise du capitalisme et l’horreur du stalinisme d’un côté et du fascisme de l’autre . Que croire ? Qu’espérer ? Ces questions étaient absolument importantes pour moi, et j’ai essayé d’y répondre.
A ce moment, un ami m’a présenté l’oeuvre de Karl Marx, qui est une oeuvre de philosophie, d’histoire, d’économie, qui touchait à tous les domaines. Je me suis dit «C’est ça ! Pour comprendre il faut toucher à tous les domaines». Et quand je suis entré à l’université, je me suis inscrit en philo, car le cursus incluait aussi la psychologie et la sociologie. Je me suis inscrit en histoire, car c’est capital. Je me suis inscrit en droit, pas par amour du droit, mais parce qu’on y apprenait la science économique. Et me suis incrit en sciences politiques.
C’est en cours de route que je me suis posé la question de la connaissance, laquelle est devenue centrale dans La Méthode [1977-2006, six tomes]. Pourquoi ? Parce que, quand j’ai écrit dans les années 1948-1950 mon livre L’homme et la mort, je me suis rendu compte que les connaissances dont j’avais besoin étaient dispersées dans toutes les disciplines des sciences humaines, des sciences de la vie, etc. Et qu’il ne s’agissait pas simplement de les rassembler et de les juxtaposer, mais de les organiser. Je me suis donc posé le problème de la complexité. Voyant qu’une bonne connaissance ne pouvait être que complexe (c’est-à-dire qui lie les éléments séparés), ce que notre éducation nous empêche de faire, je me suis intéressé au fait que le plus souvent on croit connaître mais qu’on se trompe, on s’illusionne. C’est-à-dire que les processus qui donnent la connaissance sont les mêmes processus qui produisent l’erreur et l’illusion.
J’ai pu rassembler une méthode pour traiter la complexité. Je suis parti de la dialectique de Hegel et le sens des contradictions d’Héraclite pour créer ce que j’appelle la «dialogique», qui montre comment, dans les problèmes importants, on arrive à des contradictions, des paradoxes. J’ai donné des éléments de méthode pour changer la façon de voir le monde, pour avoir une vision complexe, c’est-à-dire la moins trompeuse possible.
Pour comprendre il faut toucher à tous les domaines.
En même temps que j’essayais de construire une connaissance complexe de l’humain, ce que j’ai fait dans Le paradigme perdu [1973] et L’humanité de l’humanité [2001], je m’efforcais d’étudier les structures de la connaissance pour dégager les façons les moins mauvaises de connaître.
Les questions «qu’est-ce que l’humain ?» et «qu’est-ce que la connaissance ?», j’ai voulu les traiter de manière pas seulement globale, mais aussi concrète (ce que j’ai appelé la «sociologie du présent»), en interrogeant des évènements surprenants comme mai 68, le cinéma, le drame du sang contaminé, une commune bretonne, etc. J’ai essayé de connaître l’humain sur le plan concret et historique et pas seulement sur le plan général. Voilà ce qui fait l’unité d’une connaissance apparemment dispersée.
PS • Peux-tu préciser ce qu’est la pensée complexe ? Est-ce simplement une science des interactions, des interrelations ?
Edgar Morin • C’est une pensée qui étudie les liens, et particulièrement les liens entre un système et son environnement. Tout objet d’étude doit être relié à son environnement. L’une des idées clés, c’est que l’autonomie d’un être vivant est dépendante de son environnement. L’être vivant capte puis utilise l’énergie. Pour survivre, il faut connaitre sa relation à l’environnement. C’est capital.
Par ailleurs, pour moi, tout système est complexe car il est fait d’une pluralité d’éléments différents qui s’unissent. Le fait que ces éléments soient organisés ensemble fait émerger des qualités qui n’existent pas dans ces éléments, ce qui est aussi absolument capital. Les qualités de l’eau ne sont pas dans les molécules d’hydrogène et d’oxygène. Les qualités de l’être humain ne sont dans aucune des molécules qui le constituent. La leçon est que le système est plus que la somme des parties. Mais il peut aussi être moins ! Car il y a des contraintes. Disons que le tout est différent de la somme des parties, c’est aussi fondamental.
PS • Pour connaître l’humain, il faut connaître l’environnement… Tu as donc été obligé de t’intéresser aux sciences de la nature (physique, chimie, etc.) et aux sciences de la vie (biologie, etc.). Beaucoup de chercheurs en sciences humaines sont irrités ou se méfient encore de l’intrusion de ces sciences dans leurs domaines par peur de l’essentialisme et du déterminisme. Comment vois-tu cela ?
EM • Parce qu’ils n’ont pas compris, ils y ont vu une réduction(1). Ils ont voulu réduire les sciences humaines. Alors que moi, dès le début, avant même les débuts de l’écologie, j’étais animé par cette phrase d’un manuscrit de jeunesse de Karl Marx : «Les sciences de l’Homme embrasseront les sciences de la nature et les sciences de la nature embrasseront les sciences de l’Homme». Ça veut dire quoi ? Que l’humain est issu d’une évolution biologique, c’est un animal. Mais les sciences de la nature sont les produits historiques des civilisations et notamment de l’actuelle, qui a produit les sciences.
Avec ma conception, il est impossilble de réduire l’un à l’autre, et il faut les faire communiquer. Il faut comprendre l’«unidualité» de l’humain : il est un tout en étant double. Il est culturel et naturel. La complexité, c’est cela. Les esprits formés à la pensée binaire et disjonctive(1) ne peuvent pas croire qu’on peut combiner les deux : ou bien on est du côté naturaliste ou bien culturel. Par exemple en sciences cognitives, dans la tradition de Stanislas Dehaene, etc., tout s’explique par le cerveau, l’idée même d’émergence de l’esprit ne leur vient pas ! La pensée complexe est incompréhensible dans le cadre de la pensée binaire.
(1) Le mode de connaissance dominant en Occident (la science) est basé sur le principe de réduction (qui consiste à connaître un tout composite à partir de la connaissance des éléments premiers qui le constituent) et sur le principe de disjonction, qui consiste à isoler et séparer les difficultés cognitives les unes des autres, ce qui a conduit à la séparation entre des disciplines devenues hermétiques les unes aux autres.
PS • C’est ce que d’autres appellent la société du «ou» (ce que tu appelles la pensée binaire, la disjonction). Peux-tu retracer brièvement l’histoire opposée, celle de la pensée du «et», de la pensée que j’appelle horizontale ?
EM • Le «et» unit des notions qui en général se repoussent. Par exemple Héraclite dit : «Concorde et discorde sont père et mère de toute chose». Ces notions semblent incompatibles, mais c’est l’univers, c’est l’univers cosmique, c’est l’univers biologique, c’est l’univers humain. Partout où tu vois Eros (les forces d’amour, d’union, d’association), il y a aussi Polemos (les forces de discorde) et Thanatos (les forces de destruction et de mort, à commencer par le deuxième principe de thermodynamique). Bien sûr, il y a des cas où on peut dire «ou bien…, ou bien…», mais en général, dans la pensée commune, on oppose trop souvent ce qui devrait être lié.
Cette pensée est issue d’un courant, toujours très minoritaire dans le monde occidental, qui commence avec Héraclite mais qui reste très solitaire dans l’Antiquité greque, et que l’on retrouve un peu dans la pensée gnostique et mystique, mais qui en général n’intéresse pas les gens à cause du côté non rationnel. Puis ce sens des contradictions réapparaît dans la dialectique de Hegel, qui le surmonte un peu trop facilement, mais qui, au moins, l’affronte. C’est transmis à Marx, et ça s’est dénaturé dans les marxismes les plus vulgaires. On peut récemment le retrouver dans les avancées scientifiques de la physique, par exemple à partir du moment où Niels Bohr a énoncé le paradoxe que la lumière est à la fois particule et onde.
C’est une éducation de pensée. Evidemment, la pensée chinoise, avec le Tao, le Yin et le Yang, sait manier les antagonismes qui sont en fait complémentaires. Ici, il faut une «repensée», mais c’est très difficile car des structures de notre pensée ont été imposées dès l’école primaire et secondaire. Il n’y a que les esprits qui ne sont pas à l’aise dans ces structures qui peuvent s’en évader ou faire des incursions ailleurs. Il y en a mais c’est une minorité.
PS • Effectivement, avec la collapsologie, nous avons eu à coeur de tisser des liens entre disciplines. Et j’ai remarqué que cette pensée complexe et systémique attirait aussi les renégats, les gens pas à l’aise dans le système de connaissances actuel, les hypersensibles, etc. C’est paradoxal, ces personnes sont à la fois nombreuses et peu nombreuses.
EM • Oui, on est dispersés.
«Concorde et discorde sont père et mère de toute chose.» Héraclite
PS • Ce qui m’a aidé dans la pensée complexe, ce sont les notions d’irréversibilité, d’incertitude, d’interrelation, d’interdépendance, de seuils, de holons, d’hystéresis, etc. et que tu as bien décrites dans La Méthode. Ce sont des idées clés qui aident à penser les catastrophes. Mais il semble que notre monde continue dans la pensée binaire et réductionniste et n’a donc pas pris la mesure du changement de paradigme, mais aussi des ruptures à venir…
EM • Oui, et à ce titre, la pensée d’Ivan Illich [1926-2002] est très intéressante, car il montre que les avantages de la technique, à partir d’un certain seuil, deviennent nocifs. Par exemple, la bagnole qui sert à aller vite, devient très lente dans les embouteillages, mais ça s’observe aussi pour le trop d’école qui forme des moutons, pour le trop d’hôpital qui rend malade, etc. Cette idée est capitale parce que quand on a affaire à des bienfaits, on ne peut pas voir les méfaits propres aux bienfaits.
Prenons par exemple l’individualisme qu’a développé notre civilisation occidentale. Il est évident que c’est une chose très positive qui a permis beaucoup de choses (choisir son métier, son mariage, etc.), qui a permis plus d’autonomie, de développer des talents que les familles interdisaient, etc. Mais en même temps se développait la dégradation de toutes les solidarités traditionnelles, la création de solidarités purement bureaucratiques, la perte de cette solidarité concrète qu’est la fraternité et la refermeture égoiste de beaucoup de personnes.
Dans le fond, la vie humaine ne s’épanouit que lorsque la personne s’épanouit au sein d’une communauté où il y a du «tu» et du «nous». Notre société tend à détruire le nous, il y a clairement une dégradation. Comprendre que ce qui est positif peut amener du négatif au delà d’un certain seuil, c’est fondamental. Oui, le Smartphone c’est merveilleux, mais dans la globalité, on voit aussi tous les dangers et les menaces qui s’accumulent. Il est évident qu’on a besoin de la complexité, qui elle-même apporte de l’incertitude.
Il y a une chose que les gens ne comprennent pas : ils croient que la complexité c’est la complétude, qu’on prétend à une connaissance complète. On aimerait ! Mais on sait qu’on ne l’a pas. On sait que l’avenir est tissé d’incertitude. L’introduction de l’incertitude au coeur de la pensée complexe lui permet d’être ni absolue ni dogmatique. C’est une pensée qui est un pont jeté sur la réalité et qui peut très bien ne pas être adéquat. Et il ne faut pas oublier que la rationalité elle-même a des limites ! Dans le fond, la vraie rationalité est ouverte sur ce qu’elle ne peut pas comprendre, elle ne rejette pas comme superstition et pure imbécilité ce qui est en-dehors de son champ. Ce qu’on appelle la «rationnalité normale», c’est une pensée réduite à la pensée aristotélicienne, c’est-à-dire qui élimine la contradiction. Or, dès qu’on arrive à un problème profond, il y a des contradictions qui apparaissent et l’obscurité surgit.
PS • Est-ce cela la cause de nos maux ?
EM • Oui, malheureusement, et il faut ajouter que la forme de connaissance spécialisée, enfermée dans des disciplines, qui ne peut être que juxtaposée et non synthétisée, elle-même s’accompagne d’une domination de la pensée technico-économique. On glisse de la connaissance au calcul. On veut que la connaissance soit quantifiable. Pour toute une pensée dominante et gouvernante, les phénomènes humains se réduisent au calcul : c’est le PIB, les sondages d’opinion, etc. L’humain est vu uniquement comme chiffre et jamais dans sa réalité concrète d’affectivité et de souffrance. Cette pensée-là est sous une forme dégénérée, car bien entendu le calcul est tout à fait nécessaire comme auxilliaire, et même l’intelligence artificielle peut rendre des services, mais l’IA comme norme régissant l’harmonie d’une société, c’est une absudité totale, car l’harmonie est impossible et que la créativité, l’invention, l’accident arrivent sans cesse et c’est le fait de l’histoire.
PS • Qu’est-ce que tu appelles «métamorphose» ?
EM • Quand j’ai écrit La Voie [2011], j’ai constaté que la mondialisation, c’est-à-dire le développement économique, technologique et scientifique, est une voie qui mène à des catastrophes. Une autre voie est nécessaire, mais pour cela, il faut un très grand nombre de réformes dans tous les secteurs, dans tous les domaines ; il faut que toutes ces réformes puissent converger, comme des affluents de rivières ; et il faut, à un moment, créer une nouvelle voie. C’est cette nouvelle voie, ce nouveau courant qui porterait la métamorphose, c’est-à-dire la capacité, à partir de tout ce que nous avons comme héritage potentiel culturel et cérébral, de faire quelque chose d’autre. Non pas une société parfaite, mais un autre monde, meilleur, qui serait une société à l’échelle planétaire, une terre patrie. C’était l’idée de La Voie.
PS • Peut-on dire que l’effondrement est le premier stade de la métamorphose ?
EM • L’effondrement peut être un stade préparateur d’une métamorphose. On est dans le possible. Mais la question est de savoir s’il s’agit de l’effondrement ou des effondrements. Evidemment, on est dans une époque d’interdépendance généralisée. On a vu la même histoire avant 1928, la crise a permis à des autarcies de se faire (l’Allemagne autarcique par exemple). Elle a permis à des économies de subsistances de subsister.
Je crois qu’un effondrement global et généralisé est difficile à concevoir. Un effondrement généralisé, je ne le vois pas, car je vois subsister les zones régressives, mais où l’on maintient une économie de subsistance. Je vois que peut-être les régions les plus archaiques où perdure la polyculture, où une pluralité d’activités peuvent subsister… Je vois par exemple avec le réchauffement climatique la possibilité pour certaines zones comme la Sibérie de devenir fertiles en oliviers, en vignes et céréales, etc.
La planète, sur le plan de la vie, a connu un effondrement épouvantable à la fin du primaire (plus de 80% des formes de vie ont disparu). Celles qui restaient ont permis le surgissement de nouvelles espèces. Et il y en a eu d’autres ! Ces effondrements ont permis le développement des petits carnassiers, des petits rongeurs.
PS • Un effondrement n’est donc pas la fin de tout, c’est le début d’autre chose… mais on ne peut pas savoir quoi.
EM • Exactement. On ne sait pas quoi. Il y a des effondrements planétaires, par exemple des météorites qui causent des phénomènes volcaniques, lesquels entraînent une chute de la température, etc. Il y a un enchaînement de causes et d’effets…
PS • Mais là tu parles de grands effondrements de la vie sur Terre. A l’échelle globale, la vie subsiste. Mais si nous prenons juste le cas des dinosaures, ils ne sont pas revenus. Et si nous prenons le cas de notre société, où disons de la «mégamachine», comme l’appelait Lewis Mumford… elle peut s’effondrer, non ?
EM • Les vrais anéantissements ont été la défaite d’empires par d’autres empires. Quand les Perses ont pris Babylone, ils ont tout détruit de la civilisation babylonienne. Mais quand tu vois l’histoire de l’Egypte, il y a différentes conquêtes, mais elles n’ont pas entièrement détruit la civilisation égyptienne. C’est surtout le christianisme et l’islam qui ont transfiguré l’Egypte. Il y a une telle complexité d’effets et de causes… Je vois des îlots de survie, des oasis.

PS • Il n’y a pas une cause, ce n’est pas blanc ou noir. Ce n’est pas simple…
EM • Ce qu’il y a de très cohérent dans votre livre Comment tout peut s’effondrer, c’est que vous voyez l’ensemble des processus extrêmement divers qui poussent aux catastrophes. Mais ces processus eux-mêmes peuvent se trouver modifiés. Et quand je dis catastrophes, c’est au pluriel. Je ne sais pas de quels ordres seront ces catastrophes. On peut penser qu’une catastrophe de guerre civile ou étrangère, nucléaire, etc. se combinent, effectivement, mais je ne le vois pas de manière généralisée.
Et dans le processus catastrophique que vous appelez «effondrement» – mais moi je ne donne pas de nom -, il y a l’autre processus minoritaire du transhumanisme qui va faire que dans certaines colonies préservées géographiquement – que ce soit le Tibet, l’Australie, je ne sais pas -, une race de superhumains génétiquement modifiés et disposant de tout le matériel (IA et prothèses) se développe avec des pouvoirs inhumains (car superhumains) en laissant le reste de l’humanité croupir dans la misère et la famine, dans la situation de Mad Max, ou comme dans le film Elysium…
Dans mon esprit, l’incertitude est dominante, la vigilance aussi… tout en voyant que l’ensemble des processus en cours conduise à ces catastrophes et vers cette minorité superhumaine. Mais je ne peux pas voir plus.
J’insiste sur ce que j’appelle les oasis de résistance, de fraternité, de «vie autre», d’autonomie, mais dans le sens où ce n’est pas seulement une possibilité d’autonomie de subsistance qu’offre l’agroécologie, il y a aussi avec les possibilités qu’offrent les «makers». Les makers c’est un évenement capital ! C’est la capacité de produire artisanalement ce que produit l’industrie. Avec ce mouvement des makers, on voit que les oasis peuvent subsister.
Il y a une chose qui m’avait beaucoup frappé à l’époque. J’ai visité dans l’Etat de Tocantins [au Brésil] une oasis existant depuis le XIXe siècle, une colonie de nègre-marrons, c’est à dire de noirs qui avaient fuit l’esclavage. Il avaient réussi à faire une petite machine à fabriquer du sucre. Avec le minimum agricole, ils avaient vécu en autarcie pendant plus d’un siècle ! Jusqu’à l’époque de Lula, où l’Etat brésilien les avait reconnus.
Je pense beaucoup à ces oasis multiples qui pourraient se développer parce qu’il y a une foule d’associations et de solidarités qui subsistent. D’ores et déjà, nous avons, avec ces oasis, l’arrière-garde de défense contre l’immense montée des forces régressives et destructives qui risquent de redevenir l’avant-garde au cas où leurs forces diminueraient. C’est comme ça que je vois les possibilités de régénération.
PS • Et avec une grande incertitude… Prenons le parallèle avec la guerre : en 1940-1941, en France, c’est une situation d’effondrement. Tout bascule, on ne sait pas quelle sera l’issue de la guerre, on ne sait pas si on va s’en sortir, il y a des îlots de résistance, de l’incertitude, il y a de la souffrance… Les gens vivent déjà une sorte d’effondrement social et politique, et pour certains intérieur. Toi qui as traversé cette époque, comment l’as-tu vécue ? Comme un effondrement ?
EM • Voyons d’abord l’histoire. La France s’effondre, une partie de la France est occupée par le régume de Vichy. Moi, je vis en zone sud qui n’est pas occupée. En quelques mois s’installe la pénurie. On a faim, on se démerde. Or, pendant ce temps-là, l’Allemagne nazie domine toute l’Europe. Elle déclenche l’offensive sur l’URSS et elle semble triompher, puisqu’elle est aux portes de Moscou en octobre 1941. Tout semble réglé. Moi, qu’est-ce que je suis à l’époque ? J’ai 20 ans, je n’ai pas d’espoir. J’étais anxieux, attentif. J’étais sympathisant de mes amis résistants, j’allais à leurs procès.
En décembre 1941, tout change ! C’est la première contre-offensive soviétique victorieuse qui sauve Moscou assiégée, et c’est Pearl Harbor, qui fait que l’Amérique entre en guerre. Une fois que je sens que la guerre devient mondiale, je me dis que je ne peux pas rester à l’écart de cette lutte insensée et dantesque qui a lieu. Il faut que je me donne. C’est là que l’espoir est né. Il était très faible, et il s’est consolidé en automne 1942 avec la résistance de Stalingrad. Il a fallu un début d’espoir et un évenement imprévisible.
Je vois des îlots de survie, des oasis.
PS • Et ça t’a révélé. Tu es devenu pleinement toi-même…
EM • C’est à ce moment-là que j’ai compris la différence entre vivre et survivre. Je n’avais pas le temps, je voulais vivre. Survivre quelque part et me planquer, ce n’est pas vivre. J’ai compris que pour vivre à ce moment-là, dans ces conditions, il fallait risquer sa vie.
Ce qui s’était effondré, c’était la République, l’armée française, des choses comme ça. Mais prends la Pologne, par exemple : elle est partagée entre la Russie et la Prusse. C’est un pays qui n’existe plus, jusqu’en 1919, puis les vainqueurs reconstituent la Pologne en ramassant les morceaux. Et là dessus, en 1939-1940, l’Allemagne et l’URSS se partagent à nouveau la Pologne… jusqu’à la fin de la guerre où elle se reconstitue. On voit très bien qu’un pays qui s’est effondré peut se reconstituer. Tiens, par exemple, les Kurdes, c’est un vrai peuple, ils n’ont jamais bénéficié d’une nation organisée. Ils aspirent à cela, mais ils ne le trouvent pas. Si surgit une opportunité historique, ils vont devenir une nation. On ne sait pas !
L’effondrement de l’empire romain, c’est une civilisation qui s’effondre, avec le retour à un monde purement agricole et la dislocation d’une organisation étatico-impériale. Mais quand-même, l’Empire byzantin a duré jusqu’au XVIe siècle. Et il aurait pu durer si les Turcs ne l’avaient pas démoli. Il y a des forces de résistance et de renaissance.
La seule grande différence, c’est qu’aujoud’hui, tout est beaucoup plus mondialisé et interdépendant, et que le phénomène écologique relève de toute la planète et ne peut pas être localisé. Les forces catastrophiques sont universelles. On est dans cette situation où le type d’effondrement qui peut surgir sera d’un type nouveau, du point de vue humain. Parce que jusqu’à présent la chute de l’Empire romain n’a pas affecté l’Empire chinois.
PS • Les civilisations restent humaines. Mais le Sahara, les espèces, etc. ne reviennent pas. Il peut aussi y avoir des phénomènes irréversibles…
EM • Certes, il y a des choses irréversibles, mais qui donnent naissance à d’autres formes nouvelles régénératrices. La réversibilité n’existe pas. Mais il existe des possibilités de régénération.
Je ne dis pas que c’est un argument, mais c’est pour montrer que les choses résistent. Regarde : les Romains ont anéanti une grande partie du trésor culturel grec. Des pièces d’Euripide, d’Eschyle, de Sophocle, etc. Ce qui s’est passé, c’est que dans le fourgon des esclaves grecs, il y avait des penseurs, et finalement, selon la parole d’Horace, «la Grèce vaincue a vaincu son féroce vainqueur» : la culture grecque s’est infiltrée dans l’Empire romain et a triomphé dans l’Empire byzantin. Autrement dit, les vaincus ont été les vainqueurs culturels. Mais ça ne suffit pas. Quand il y a eu la destruction des uns et des autres, ce sont des Arabes syriaques qui ont commencé à traduire Aristote et Platon. Ils les ont traduits dans le monde arabo-musulman et ça a été entretenu par des penseurs semi-laïques arabes. Tous ces penseurs grecs sont passés par les Arabes et sont arrivés à la Sorbonne ensuite !
Ceci dit, oui, il y a eu une grande déperdition, beaucoup de choses sont anéanties. Si tu prends Héraclite, par exemple, qui est à mon avis le plus grand génie qui soit, on a perdu beaucoup de son oeuvre, il ne reste que des fragments. Il y a des anéantissements irréversibles, ça c’est sûr. Quelle sera la mesure de ces anéantissements dans les catastrophes qui viennent ? Je ne le sais pas. Regarde comme aujourd’hui la conservation des documents électroniques est fragile par rapport au papier ! Tout cela peut être anéanti facilement.
PS • Et encore le papier est très fragile !
EM • Tout à fait. Et, du reste, on voit qu’aujourd’hui, l’une des formes d’anéantissement, c’est la cyberguerre. Tu peux détruire cybernétiquement toutes les structures d’un état, les banques, les administrations, les registres, etc.
PS • On est dans une civilisation/société du paradoxe, qui est à la fois puissante et fragile. Est-ce qu’on serait entré dans l’ère des paradoxes ?
EM • Je pense que les paradoxes ont toujours été actifs. Mais là, je vois un certain nombre de paradoxes capitaux, propres à notre ère. L’un est celui-ci : il y a aujourd’hui une communauté de destin terrestre. On a tous les mêmes périls, les mêmes dangers, les mêmes menaces. On devrait prendre conscience de cette communauté de destin, d’autant plus qu’on a un héritage humaniste, c’est-à-dire qu’on considère que tous les êtres humains méritent une égale reconnaissance de leur pleine humanité. Cet humanisme élimine tout racisme, discrimination, supériorité nationale, etc. Nous savons maintenant, grâce aux sciences, que tous les êtres humains sont identiques, mais que chacun a sa différence. C’est l’unité dans la pluralité et la pluralité dans l’unité. Avec ça, nous avons tout ce qu’il faut pour prendre conscience que désormais l’humanisme cesse d’être abstrait. On est tous des humains membres d’une même patrie qui est la Terre, donc frères.
Et malgré les conditions réunies pour que cette conscience émerge, on a affaire, vu les inquiétudes, les angoisses liées à l’incertitude du futur, à une refermeture des esprits sur des identités nationales, éthniques, religieuses, etc. Normalement, on devrait dire qu’on est tous humains et frères tout en étant français, chinois, etc., et c’est le contraire qui arrive ! C’est le plus grand paradoxe de notre époque.
PS • En quoi la pensée complexe, la dialogique, pourrait être un outil pour apprendre à naviguer dans ces paradoxes ?
EM • C’est justement elle qui nous dit qu’il faut comprendre que la diversité du genre humain est le trésor de l’unité humaine, et que l’unité, c’est la diversité. C’est elle qui devrait nous faire comprendre ça. Nous faire voir qu’à travers les différences, il y a cette communauté de destin, au lieu d’hypostasier les différences. Mais ce n’est pas seulement la pensée complexe… La moindre rationalité ouverte devrait nous le faire voir.
C’est un paradoxe et une tragédie. S’il y avait cette communauté, on serait mieux armé pour lutter contre tous ces périls… Et toujours sans savoir si on pourrait y arriver et s’il n’est pas déjà trop tard, ça je ne sais pas.
PS • Tout à l’heure, tu parlais de la Résistance. C’est très présent dans ta vie…
EM • Oui, c’est la période la plus vivante de ma vie, la plus forte. J’ai des souvenirs très précis, avec des dates, des émotions.
PS • Qu’est-ce que «résister» voudrait dire aujourd’hui ?
EM • Comme je le dis souvent, il s’agit de résister aux deux barbaries. La vieille barbarie que l’on a connu et qui ressuscite, avec la haine, les massacres, les destructions, les attentats, les mépris, etc. Et la barbarie glacée, fondée sur le calcul et le profit de notre propre civilisation. Les deux barbaries sont associées parfois. A mon avis, on peut résister à ces deux barbaries dans ce que j’appelle les oasis.
PS • Pourrait-on créer un nouveau Conseil National de la Résistance ? Et même pourquoi pas un Conseil National de la Résilience ?
EM • C’est trop tôt. Et il faudrait un conseil international…
PS • Si on arrivait, par un coup de baguette magique, à mettre en place toutes tes propositions décrites dans La Voie, est-ce qu’on pourrait éviter un effondrement ? Est-ce qu’on l’accélèrerait ? Est-ce qu’on diminuerait la possibilité de catastrophes ?
EM • Si cette Voie se dégageait, il y aurait sûrement un certain nombre de catastrophes, mais on éviterait l’effondrement généralisé. Mais on ne sait absolument pas si elle pourra se dégager. J’ai écrit ce livre il y a quelques années. Il a eu des lecteurs, mais il n’a pas eu de résonance dans le monde politique. L’impact a été dispersé sur des gens, mais il n’a pas servi à changer la conscience des responsables politiques.
PS • Ça t’étonne ?
EM • Non, puisque je sais que non seulement ils vivent dans un certain type de pensée, mais il vivent au jour le jour, dans l’immédiat, dans l’absence de toute pensée historico-politique. Il y a une dégradation énorme de la pensée politique. Même avec ses énormes lacunes, le marxisme était une forme de pensée. ll y avait une pensée de gauche et une pensée de droite structurées.
C’est cela aussi un paradoxe. On est dans une société de l’information. Mais l’information n’est rien tant qu’elle n’est pas organisée en connaissances. Et on est dans une société des connaissances «séparées», mais pas de «la» connaissance. Et donc le type de connaissances qui est utilisé a de telles limites qu’elle sert plus à aveugler qu’à élucider.
Se répète maintenant ce que j’ai vu avant-guerre : une marche somnambulique vers des désastres alors qu’on a les éléments. Mais on continue au jour le jour, on ne voit pas le message. A l’époque, on ne voyait pas le message de l’hitlérisme, de la guerre d’Espagne, de Munich, de tous les éléments qui surgissaient. On vivait au jour le jour dans les problèmes locaux. Aujourd’hui c’est pareil.
PS • Et aujourd’hui, es-tu plutôt dans l’espoir ou dans cette sensation étouffante et désespérée de «France occupée» ?
EM • Ni l’un ni l’autre, je suis dans la continuation. Tous les exemples historiques me montrent que les pensées déviantes mettent beaucoup de temps avant de s’enraciner, avant de créer leurs réseaux, avant de devenir des forces historiques. Ça a été vrai pour la pensée de Marx, de Jésus, de Bouddha, pour toutes les innovations, tout ce qui rompt avec la croyance établie. Il faut passer par un certain temps inconnu et incertain de prêche dans le désert, et après arrivent peut-être des conditions favorables pour que ça fleurisse…
PS • J’aimerais aborder la mort. Tu as écrit un livre sur la mort, tu as vécu des événements marquants comme la mort de ta mère. J’ai remarqué que beaucoup de collapsologues avaient un rapport apaisé à la mort, ou étaient passés par des épreuves difficiles. Quel est ton rapport à la mort ? Comment vis-tu avec l’idée de la mort ?
EM • Premièrement, c’est vrai, l’évenement principal de ma vie, c’est la mort de ma mère, j’étais enfant unique, j’avais 10 ans. A cet âge, on sait que la mort ce n’est pas comme dans les dessins animés, c’est un anéantissement. Bref, j’ai vécu de façon horrible cette mort, d’autant plus que je l’ai découverte alors que mon père me la cachait, et ça m’a mis en révolte contre ma famille. Ça m’a rendu très solitaire et malheureux. L’année suivante, j’ai eu une étrange maladie que les médecins n’ont pas comprise, et qui était probablement mortelle. Tout ça m’a donné un sceptiscime général, et un besoin de tendresse, d’amour, de communion. C’était un évenement capital pour moi.
Ensuite, il se trouve que j’ai des amis et de la famille qui ont été arrêtés et tués, qui sont morts dans les camps de concentration. J’ai aussi risqué ma vie dans la résistance, et j’ai échappé deux ou trois fois par miracle à des pièges qui m’ont été tendus. J’ai eu plusieurs rendez-vous avec la mort, y compris à l’hôpital. Dans le fond, c’était du fait des marques de ces morts que j’ai voulu faire un livre sur la mort. J’ai voulu non pas regarder la mort, mais comprendre comment nous considérons la mort. Donc c’est un objet que j’ai traité.
Mais ce qui m’a psychanalysé, c’est avant-tout la guerre, la résistance, le fait de risquer ma vie. Ça m’a fait beaucoup de bien.
Et puis avec les années, la mort de mes meilleurs amis, de mes frères, ça marque beaucoup. Sans arrêt, j’ai dans l’esprit la chanson du Pauvre Rutebeuf [de Léo Ferré] : «Que sont mes amis devenus, que j’avais de si près tenus et tant aimés ?». J’ai ces morts qui sont là, ils sont vivants dans mon esprit, ils m’ont marqué. Et puis mon âge qui s’accroît me met dans une proximité irrémédiable avec la mort.
Mais pour moi, le fait de continuer mes passions, mes intérêts, de me sentir faire partie de l’humanité, d’être une petite particule, un petit moment dans cette aventure humaine incroyable dont on ne sait pas pourquoi elle a lieu ni où elle va, où je me sens solidaire de l’aventure humaine (et notre débat en est un exemple), le fait que je continue à aimer, à m’intéresser aux choses, fait que l’angoisse de mort est refoulée. Parfois elle arrive, elle laisse un grand vide, parfois elle s’en va. Ce n’est pas la peur, c’est un sentiment d’engloutissement, c’est pire qu’une peur, c’est autre chose. C’est une absurdité incroyable. De savoir que le «moi je» qui est le seul bien que je possède, qui est tout, à un moment, il n’est rien, rien dans l’histoire humaine, il n’est rien dans l’histoire de la vie, il est moins que rien dans l’histoire de l’univers. Je sais que je ne suis rien et que je suis tout, c’est aussi un paradoxe.
Mais je continue à avoir des plans et des projets, tout en sachant que tout cela peut s’arrêter n’importe quand.
PS • Avec le recul de 50 ans… Si tu pouvais voyager dans le temps et que tu revenais dans les années 1970, au début de la pensée écologiste, de la création du parti Vert, tu leur dirais quoi ?
EM • Je leur dirais que 50 ans plus tard, les progrès ont été très minimes. Malgré Three Miles Island, malgré Tchernobyl, malgré les pluies acides, malgré la destruction de la biodiversité et des sols agricoles. Malgré tous ces facteurs énormes, la conscience écologique reste très petite et très limitée. Et on reste aujourd’hui très focalisés sur le changement climatique, mais il y a tout le reste.
A l’époque, on était peu nombreux. Il y avait René Dumont, André Gorz, Serge Moscovici et moi. On était au moins quatre à essayer d’apporter une pensée écologiste globale en France. Les autres du parti des Verts s’en foutait complètement, parce que la tendance a toujours été de voir les détails, les petites luttes, les problèmes hétéroclites, sans voir l’ensemble. Ils étaient étroits, ils se livraient à des querelles stupides de personnes, alors qu’en Allemagne, le parti écolo en liaison avec les sociaux démocrates, a pu participer à la création de villes un peu humanisées. Ici, ils n’ont rien pu faire.
PS • Si tu avais la possibilité de rencontrer Héraclite, que ferais-tu ? J’imagine que tu lui demanderais une interview pour Yggdrasil !
EM • [Rires] D’abord je l’embrasserais ! Puis je lui demanderais de préciser, de me raconter tout ce qui a disparu de son message, les passages de son oeuvre qui ont été perdus au fil des siècles, je l’écouterais, je prendrais note. «Eveillés, ils dorment», disait-il. C’est à mon avis la condition humaine.
PS • Comment est ton quotidien, maintenant ?
EM • Il est dans un lieu qui me charme, à Montpellier, au coeur d’une ville historique piétonne. J’ai de la verdure, du ciel, un paysage méditerranéen. Je continue mes activités intellectuelles, il m’arrive de faire encore des conférences. Et même je risque d’être un peu débordé ! J’essaie de trouver un rythme de vie, car on est encore en pleine installation avec ma femme, Sabah. C’est très important, j’ai toujours eu besoin du feu, de l’amour.
PS • Comment vois-tu la suite ?
EM • Je ne vois pas.
PS • Merci Edgar, je voudrais dire que je t’aime, tu m’as beaucoup touché, influencé, apporté, à travers ton oeuvre et ta personne. Ca a été très important pour moi de sentir qu’il y avait une autre manière de penser, qui me correspondait, et qu’on pouvait aller loin avec ces connaissances…
EM • Merci ! J’ai été très content. Et on n’a pas épuisé le sujet de l’effondrement… Ce n’est pas fini !
Pour découvrir l’oeuvre d’Edgar Morin
- Synthèse : Penser global (Flammarion, 2016)
- Sur la complexité : Introduction à la pensée complexe (Points, 2014)
- Sur l’éducation : Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur (Points, 2015)
- Sur l’écologie : La nature du futur ; Ecologiser l’Homme (Lemieux, 2016)
- Son parcours : Edgar Morin, L’aventure d’une pensée (Sciences Humaines Hors-série n°18 – mai/juin 2013)
- Ses influences : Mes philosophes (Fayard/Pluriel, 2013)
- Les bases d’une nouvelle pensée : La Méthode (coffret 6 tomes), (Seuil, 1977-2004)
- Ses propositions politiques : La voie (Fayard/Pluriel, 2012)