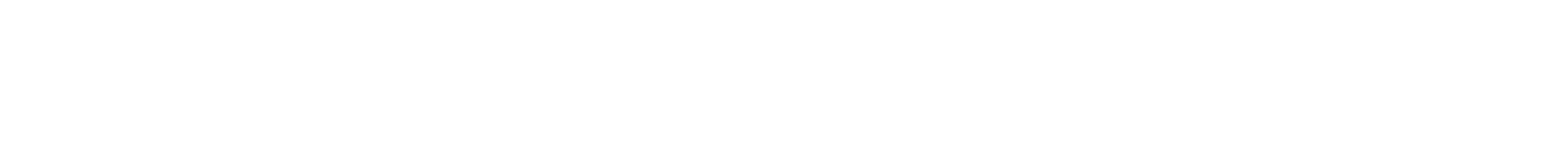Guillaume Faburel est un géographe à contre-courant, qui dénonce la barbarie des grandes villes et prédit leur démantèlement nécessaire, à l’heure où tous les promoteurs de la startup nation ne parlent que de smart city et de mégalopoles. Interview.
J’ai croisé la route de Guillaume Faburel entre deux confinements, dans un café de la gare de Lyon, à Paris. Ce professeur de géographie et d’urbanisme à Lyon 2 et à science-po Lyon terminait un séminaire sur le thème de son dernier essai, Pour en finir avec les grandes villes (Ed. Passager Clandestin, 2020). Un appel à arrêter les bétonneuses et à imaginer une écologie post-urbaine.
Pour un média intitulé Escape the city, ç’aurait été un comble de passer à côté de ce chercheur ! De ne pas l’interroger sur les limites de l’urbanisation frénétique contemporaine. De ne pas lui demander ses conseils pour se libérer de la ville.
Lire aussi : Jean Leclercq, architecte du monde d’après. “J’ai développé une foi dans un avenir incertain.”
Dans Pour en finir avec les grandes villes, Guillaume Faburel dénonce la collusion entre les pouvoirs économiques et politiques, unis par le même fantasme de la « métropolisation du monde », dont la smart city est le dernier avatar. En réponse à ce modèle unique, qui nous transforme tout.es en pangolins, il appelle à « faire corps avec le vivant ». J’avais, évidemment, envie d’en savoir plus.

Entretien
Jacques Tiberi : Je passe beaucoup de temps dans l’Eure (Normandie). Et je suis frappé de voir combien des villes comme Evreux et Bernay aspirent tout : habitants, investissements, commerces, administrations… Alors que les villages alentours sont transformés en dortoirs ou mouroirs. C’est ce phénomène là que vous appelez la métropolisation ?
Guillaume Faburel : En quelques sortes. En France, les villes moyennes sont « en déclin » ou « de confins » depuis quarante ans. C’est un phénomène assez hexagonal. Ce n’est pas le cas en Allemagne, ni toujours en Italie, par exemple. En France, on ne connaît qu’une chose : l’hyper-centralisation urbaine. C’est cela qu’on appelle la métropolisation. Pour l’expliquer simplement, je dirais que la métropolisation crée une disproportion, un déséquilibre entre les grandes villes et le reste du pays. Les premières ont capitalisé, elles ont développé des activités et sont devenues des pôles d’attractivité concurrentiels. Les autres meurent à petit feu.
JT : Oui, mais Evreux n’est pas une « métropole », comme peut l’être Lille. C’est une « petite ville de province » comme on dit…
GF : Avec le temps, la métropolisation est devenue un modèle unique, calqué sur le modèle parisien. Cette idéologie a colonisé, elle a contaminé les petites villes. Et aujourd’hui, nombre de villes, y compris moyennes et petites, reproduisent le même modèle unique. Un peu comme des poupées gigognes, le modèle se décline à l’échelle des métropoles régionales et des villes moyennes. On a un effet quasiment mimétique : enrichissement d’un côté, paupérisation de l’autre.
Recettes parisiennes
JT : Pourtant, je pensais que le modèle parisien c’était « un centre riche et des pauvres en banlieue ». Alors qu’à Evreux, par exemple, c’est l’inverse : les pauvres vivent en ville dans de petits appartements et les riches en périphérie dans des maisons avec jardin…
GF : Je sais qu’Evreux est connu pour ses cités HLM. Mais le cœur de ville d’Evreux demeure fort bien doté en patrimoine immobilier et en système commercial. Beaucoup d’argent public a certainement été dépensé pour cela, et il faut savoir qu’actuellement, il y a plus de 200 villes moyennes qui reçoivent des aides de l’Etat pour redynamiser leur cœur de ville, sur la base des recettes « parisiennes » de piétonisation, de réhabilitation du patrimoine, d’installation d’enseignes commerciales, de transports en commun type Tram, de vélos en partage… Partout, c’est toujours le même modèle qui inspire les politiques d’urbanisme. Le but est de maintenir les classes supérieures ou de faire revenir les classes moyennes en centre ville, c’est-à-dire de poursuivre l’œuvre d’accumulation dans les centres avec pour effet l’éviction des plus modestes à la périphérie, comme ce qui se passe à Bordeaux, Toulouse ou encore Lyon et Nantes.
JT : Dans ce cas, comment expliquez-vous que ce soient justement les bobos, qui sont la cible de ces recettes « parisiennes », fuient désormais les villes pour s’installer à la campagne ?
GF : D’abord, je dirais qu’il n’y en a pas tant que ça. À ce stade, c’est autant un phénomène médiatique que réellement démographique. Mais, si je ne crois pas à une velléité sécessionniste des bobos, je crois plus à leur volonté de construire d’autres modes de vie, plus écologiques, et à sortir de l’enfer du béton, du sentiment de saturation et de suffocation que cela peut provoquer. Lors du confinement, certains ont eu l’impression d’être parqués dans la promiscuité, coincés toute la journée devant un écran. Je crois, aussi, que le méta récit de « l’urbain triomphant », de « l’émancipation par la ville » est engagé dans une crise profonde, concurrencé par une forme historique de mythologie de la campagne merveilleuse.
JT : Pensez-vous que l’histoire du couple qui abandonne son T2 en centre-ville pour une ferme à la campagne soit un « truc de riche » ?
GF : Non. D’abord, je dirais que le sentiment d’asphyxie est autant ressenti dans les quartiers populaires que dans les quartiers bourgeois. Pour autant, c’est vrai, les gens qui partent des grands espaces métropolitains, ce sont surtout les talents que les métropoles ont cherché à faire venir à coups d’investissements techniques et culturels. Ce sont les jeunes diplômés qui ont du capital social. Pourquoi quittent-ils la ville ? Pour plusieurs raisons. D’abord, parce qu’ils y sont de plus en plus paupérisés. Dans les communautés autonomes où je me suis rendu, en Bretagne, dans la Drôme, dans la Nièvre, en Lozère, les nouveaux arrivants sont très souvent des BAC+5 qui vivaient au SMIC ou des étudiants qui voulaient vivre l’aventure du nomadisme…
Fin du mois, fin du monde
JT : Pardon de vous couper, mais ce que vous me dites me rappelle le fameux slogan : « fin de mois, fin du monde »…
GF : Oui, je crois beaucoup à la jonction des deux ! Contrairement à ce que l’on croit, il y a énormément d’écologie dans les revendications des Gilets Jaunes. Sauf que ce n’est pas une écologie gestionnaire et technicienne mais une écologie populaire, sociale et relationnelle. C’est l’écologie de la survie, de la domesticité, du réusage, du partage, du jardin, etc. Pour moi, il y a une complémentarité évidente entre les deux. Mais, pour en revenir à votre question sur « l’écologie était-elle un luxe de riches ? », il faut comprendre que aujourd’hui on assiste à une évolution rapide des imaginaires. Je m’explique : les couches sociales les mieux dotées aspirent de plus en plus à remettre du sens dans leur vie, voire à la simplicité volontaire, alors que les catégories populaires, elles demeurent contraintes à un imaginaire peuplé de modernité consumériste et technologique.
JT : Ce serait pour cela que seules les CSP+ fuient la ville ? Pour fuir la société consumériste qui ne représente plus la réussite à leurs yeux.
GF : Oui. Pour un actif urbain sur-stimulé, la campagne c’est un lieu de ressourcement, de ménagement. Mais c’est surtout un espace où il va croire pouvoir retrouver une vraie communauté de vie, que la ville du supermarché ne peut lui offrir. En ville, on connaît de moins en moins son voisin de palier. À la campagne, on va pouvoir recréer des liens de solidarité. En ville, les parcs c’est pour les pigeons et la contemplation d’un fragment domestiqué de nature. À la campagne, on va refaire corps avec le vivant. En ville, on vote une fois tous les 6 ans. À la campagne, on peut participer activement à la vie locale, se rendre utile. L’urbain va trouver à la campagne un nouveau souffle. Or, ce besoin de sens n’est pas uniquement exprimé par les cadres surmenés, c’est aussi de plus en plus une source de mal-être pour des personnes précaires. Comme l’envie de gagner en autonomie et répondre soi-même à certains de ses besoins vitaux. Mais, en réalité, la différence fondamentale entre les catégories populaires, et un cadre urbain surmené, c’est que les « pauvres » pratiquent déjà la simplicité, la frugalité, la solidarité des voisins et le réusage voire l’autoproduction, mais la machine à désir promu par la marchandise va s’imposer à eux par le peu de liberté donnée dans les cadres artificialisés.
JT : Pardon de tenter de résumer ce que vous venez de dire en une image, histoire de m’assurer d’avoir bien compris. Vous voulez dire que le bobo écœuré par le McDo, ne rêve que de manger une salade de patates DIY… alors que le populo, qui en a marre de bouffer des patates tous les jours, ne pense que manger McDo… c’est cela ?
GF (rires) : grosso modo, oui. Avec alternativement une ville qui est le poison et prétendument le remède.
JT : J’aurais pourtant parié que de nombreux habitants du 9-3 ne rêvent que de quitter l’Ile-de-France qui les enferme dans des HLM, puis dans des RER, puis dans des bureaux à l’autre bout de Paris ou dans des centre-commerciaux… comme s’ils vivaient dans une sorte d’usine à ciel ouvert.
GF : Mais la ville, c’est exactement cela : c’est une usine à ciel ouvert ! Depuis la Mésopotamie antique, on sait que les grands groupements humains, avec depuis lors les villes comme étendards, sont un instrument économique conçu pour augmenter le rendement du travail. La sédentarisation, c’était la rupture du néolithique qui permet de rassembler au même endroit tous les travailleurs. Vous l’avez bien raconté : c’est une régulation de nos corps, c’est une biopolitique. On l’a vu au XXè siècle avec les cités de Billancourt, près des usines Renault. On l’a vu en Chine, de manière ultra concentrée, lors de la première croissance démiurgique des années 90. Il y a l’usine et, non loin, une barre d’immeubles où vivent les ouvriers. C’est le modèle de la ville industrielle. On veut avoir les bras à proximité.
Mégamachine métropolitaine
JT : Je comprends mieux pourquoi vous employez souvent le terme de « mégamachine métropolitaine ». Mais alors, n’existe-t-il pas un risque que la mégamachine se retourne contre ces « ouvriers libérés » qui ont fui à la campagne ? Un peu comme ces robots de Matrix qui traquent les habitants de Sion ?
GF : Évidemment, il existe des puissances marchandes qui souhaitent de plus en plus gouverner nos vies et surtout capter nos ressources, notamment notre force de travail, qui, aujourd’hui, est celle d’abord de talents du techno-management, de l’innovation technique, ou encore de la création culturelle. Et si elles considèrent que ces ressources leur échappent, elles réagiront, en faisant appel à l’Etat.
JT : Comment cela ?
GF : Regardez ce qui se passe avec le projet de loi sur les séparatismes qui interdit pratiquement la déscolarisation et l’école à la maison. Y a-t-il un nombre de déscolarisation croissant en France ? Pourquoi cette loi ? Si ce n’est pour reprendre aussi le contrôle sur des gens qui s’organisent en dehors du système. Pour préserver leurs intérêts, les puissances marchandes ont compris qu’il fallait durcir les murs de la cage. Bétonner un peu plus. C’est une des raisons pour lesquelles le pouvoir politique devient de plus en plus policier. C’est une des raisons pour lesquelles on interdit l’école à la maison, mais aussi toute possibilité d’habitat léger, ou encore de s’affranchir des règles de propriété foncière. C’est facile de ficher des écolos ou d’interdire l’installation d’une tiny house, de contraindre politiquement une communauté de se brancher aux réseaux et de déloger violemment sur une ZAD. C’est aussi à cela que sert l’Etat. Peu à peu, nous sommes confrontés à une mainmise du pouvoir marchand sur le politique, qui se plie bien volontiers à l’autorité pour sa propre pérennité, qui pourrait un jour avoir droit de vie et de mort sur les gens.
JT : À vous entendre, j’ai l’impression que la démocratie n’est qu’un leurre.
GF : Je dirais que c’est un écran. Il y a les pouvoirs visibles (les élus) et les pouvoirs invisibles (les entreprises) qui ne sont aujourd’hui soumises à aucun véritable contrôle social. Localement, les petits barons locaux sont totalement inféodés au pouvoir marchand et au pouvoir économique de grandes entreprises qui, par le BTP, le mobilier et les réseaux urbains, les transports de plus en plus grandiloquents et efficients fixent les concentrations et polarités pour conserver rendements et retours sur investissement. D’où l’accumulation des centres urbains dont je parlais précédemment. Les élus, nationaux et locaux, sont très majoritairement des gens sous influence.
JT : Et je suppose que créer un mouvement politique « autonomiste » pour changer la gouvernance des villes est utopique…
GF : Ce qui est utopique, c’est de prétendre qu’une ville de 500.000 à 1 million d’habitants puisse prétendre à l’autonomie. C’est un non-sens. Aucune terre à proximité ne permettra de prétendre à la production de qualité et aux circuits courts avec une telle concentration démographique et donc de construction. Il faudra aller encore fort loin chercher sa subsistance. Et plus encore, politiquement, l’autonomie ne se fait pas d’un claquement de doigt. C’est par exemple le travers du rapport de l’Institut Momentum sur l’Île-de-France 2050. Leur idée de redécoupage en bio-régions n’est à aucun moment envisagée sous l’angle politique de la chose. C’est assez troublant. L’Île-de-France est totalement recomposée en unités urbaines de plusieurs 100aines de milliers d’habitant.e.s, et, politiquement, on croit que ça va se faire comme ça, tranquillement !
JT : Et quelle serait la taille optimale pour construire une communauté de résilience ?
GF : Si on regarde les analyses de l’archéologie tropicale, de l’anthropologie culturelle, ou même les utopies urbaines du XIXème et des villes en transition du XXIè, sans même parler des recommandations de rapports du parlement européen ou encore de cercles d’experts bien en vue… la taille optimale se situe plutôt entre 20 et 30.000 habitants. Quand on regarde les villes en transition par exemple, 9 sur 10 compte moins de 10 à 15.000 habitants. À mon avis, il est très difficile d’organiser une forme d’auto-gestion ou d’auto-détermination au-delà de 5.000 ou 10.000 habitants, à moins de retomber dans les affres de la délégation technique, de la représentation politique et de la concentration économique.
JT : De mon côté, je me suis inspiré des organisations militaires de l’Antiquité et du Moyen Age… et les groupes humains, comme les Légions, tournent souvent autour de 500 individus. Qu’en pensez-vous ?
GF : C’est intéressant. Je travaille beaucoup avec des communautés dites existentielles ou encore des éco-lieux. Ce sont des gens qui ont décidé de créer progressivement des îlots d’autonomie, de se débrancher un peu du système. C’est notamment le cas dans la communauté Eotopia, en Saône et Loire, ou celle de Trémargat dans les Côtes d’Armor. Là-bas, on a des expériences de démocratie directe et de forme autogestionnaire sur la base d’horizontalité, voire d’assemblées. Et on note que, dès l’instant où on va sur l’autonomie écologique, c’est effectivement plutôt des communautés de 200 à 500 personnes.
JT : Quel regard portent les autorités sur une communauté off the grid, comme Eotopia ?
GF : Pour l’instant ça ne se semble pas se passer trop mal. La médiation politique se joue dans les relations de voisinage plus ou moins cordiales avec le maire. Et puis, la communauté participe de la dynamisation du coin en organisant quelques moments festifs mais surtout en mettant en réseau des activités écologiques qui tendent à se multiplier localement. Plus rarement, des communautés tentent même de faire élire leur maire dans de petites municipalités, pour changer les choses de l’intérieur des institutions locales.
JT : Pour finir, j’aurais voulu vous demander quelques conseils pour créer ma communauté autonome et résiliente en Normandie !
GF (rires) : eh bien… Déjà vous pouvez demander des conseils à d’autres communautés qui se sont récemment créées ou qui sont durablement implantées (depuis une trentaine d’années), notamment dans la Drôme, dans le Morbihan, dans le Tarn, dans la Vienne… Ensuite, pour atteindre l’autonomie alimentaire, il faudra 500 à 1000 m² de terrain cultivable par famille, avec un petit élevage d’appoint. Je vous déconseille de vous lancer en ville : pour végétaliser des villes comme Paris ou Marseille, il faut débétonner… et les sols qui ont été bétonnés ont besoin d’au moins 10 à 15 ans pour retrouver sans intrants une activité biotique permettant la culture. Par contre, si vous partez à la campagne, il va vous falloir un réseau. C’est le réseau qui fait tout. Si vous arrivez à construire un réseau local avec un partage de savoir-faire vous allez créer du lien. S’auto-former grâce aux expériences locales ainsi qu’avec quelques manuels sur le bioclimatisme, pourquoi pas québécois, c’est bien. Bricoler dans son coin, aussi. Mais rien ne vaut un réseau humain pour refaire corps avec le vivant !