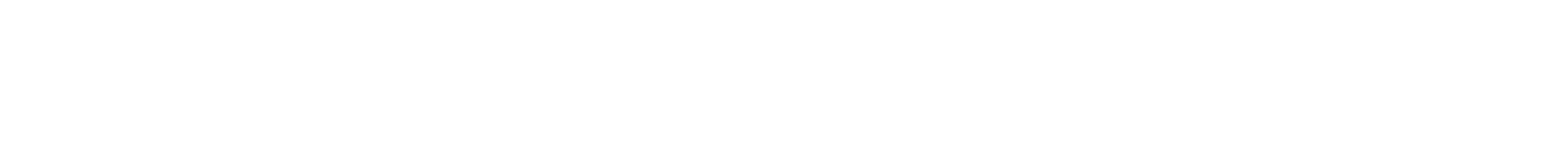L’économie de marché considère la nature comme une ressource infinie et les impacts environnementaux comme des coûts compensables. Il n’y a pas de place pour l’écologie dans ce modèle économique. L’écologie est donc anticapitaliste par définition.
Le capitalisme contemporain, fondé sur des principes libéraux des XVIIIe et XIXe siècles considère, de manière totalement infondée, que la nature n’est qu’une ressource infinie. Mais il considère aussi la pollution, le réchauffement climatique et la perte de biodiversité comme des « coûts » compensés par les gains monétaires.
L’économie de marché est incapable d’intégrer des préoccupations de long terme. Les acteurs économiques sont principalement guidés par la logique des coûts, les données monétaires, et leur prise de décision rationnelle est souvent entravée par des biais liés à la difficulté d’évaluer des phénomènes diffus se déroulant sur une période prolongée.
Lire aussi : La capitalisme ne survivra pas à +2,5°C de réchauffement (ou moins)
Le dilemme du prisonnier
Selon cette théorie, même si chaque acteur individuel a intérêt à adopter des pratiques écologiques à long terme, mais le coût initial et l’incertitude quant aux actions des autres acteurs rendent le choix de ne rien faire plus rationnel. L’écologie de marché doit être rentable. Ce qui n’est possible que grâce à des facteurs externes tels que des subventions publiques ou des pénuries.
Il reviens donc aux pouvoirs publics, en tant que régulateurs, de jouer un rôle de planification, par l’établissement de régulations et de taxes, notamment la taxe carbone. Mais les gouvernements hésitent à prendre les mesures nécessaires, face aux attentes contradictoires des citoyens, qui veulent à la fois préserver l’environnement et maintenir leur emploi, leur confort et leur niveau de vie.
La démocratie en défaut ?
Enfin, à l’échelle internationale, on note que toute mesure écologique ambitieuse est abandonnée, en raison des intérêts divergents des pays et des entreprises. Les négociations internationales sur des accords tels que les COP conduisent généralement à des promesses non-contraignantes.
Les obstacles sont donc structurels et inhérents au système économique et politique mondial. En absence de changement radical de système (économie planifiée et gouvernement mondial), les réformes resteront superficielles et donc inutiles.